
J'ai eu la chance d'assister, lundi 20 avril, lors du festival Series Mania, qui se tenait au Forum des images, à une conférence un peu spéciale, intitulée A Question of Life and Cinema. En fait un véritable cours de cinéma déroulé par Matthew Weiner, réalisateur de l'une des plus remarquables séries TV de ces dernières années, Mad Men, dont la 7ème et ultime saison est diffusée (Canal+ a entamé le jeudi 23 avril la diffusion du second volet de cette saison).
J'ai écrit à plusieurs reprises sur cela, dont ici, les séries TV sont entrées dans notre culture - notre consommation - audiovisuelle grâce à la multiplication des canaux de diffusion (coucou la vidéo à la demande sur mesure et Netflix), mais aussi parce qu'elles sont remarquablement montées en gamme ces dernières années, avec aux manettes des réalisateurs parfois venus du cinéma, et dont les codes de tournage, la qualité, empruntent de plus en plus au cinéma. Ce qui est le cas pour Matthew Weiner, cinéphile invétéré, dont on sent les influences dans son déroulé de l'Amérique des années 50, Mad Men, que j'avais chroniqué ici. Avant la saga Mad Men, il a également participé à la série de HBO, Les Soprano, doù il était scénariste et producteur des cinquième et sixième saisons.
"L’histoire de Don Draper est la même que celle de Pinocchio"
Matthew Weiner, de passage à Paris, nous a donc délivré un cours de cinéma lundi, en citant ses films de référence, qui l'ont inspiré pour Mad Men, avec extraits à l'appui, qu'il analysait à sa manière. Pour lui, il y a bien une continuité entre cinéma et séries télévisées, mais ces dernières, tout en empruntant aux codes du cinéma, ont leurs propres atouts. "Mad Men est un cinematic show. C'est une nouvelle définition de la télévision. Alors que le cinéma coûte cher : il y a plusieurs prises". D'ailleurs, il fait dire à son personnage principal, Don Draper, "Allez voir les films, pour comprendre ce qui se passe dans la culture".
Déjà petit, dans une maison sans télévision, il regardait "toujours des films le weekend", dont des films français. Dans les premiers films dont il se souvient, il cite City of lights de Charlie Chaplin, et Yellow submarine (1968), ainsi que Pinocchio ("L’histoire de Don Draper est la même que celle de Pinocchio", sourit-il). Il évoque aussi l’importance durant son enfance des sorties en famille au drive-in, alors qu'ils n'avaient pas de téléviseur. A 11 ans, sa famille déménage à Los Angeles. Là, il sera marqué en assistant en 1976, au tournage du Dernier Nabab dans son quartier de Los Angeles. Il fera ensuite une école de cinéma.
Première référence pour Matthew Weiner, Once upon a time in America de Sergio Leone (1984). La révélation pour lui. Et de citer la séquence où le jeune camarade de Noodles préfère manger un gâteau à la crème plutôt que de perdre sa virginité. Un symbole coquin pour Matthew Weiner du pouvoir du cinéma, capable d’exprimer par l’image des multitudes d’émotions que les mots ne peuvent parfois traduire.
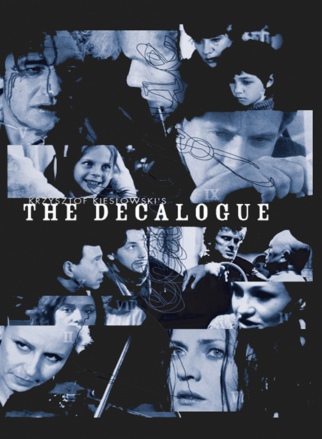
Seconde référence, Le Décalogue de Kieslowski. L'extrait qu'il a choisi (extrait du deuxième des dix segments, Tu ne commettras point de parjure) montre une scène, dans le coin d'un immeuble, où un homme meurt progressivement, au rythme du goutte à goutte insupportable d'un robinet. "C'est une masterpiece: on y voit les différentes parties du même immeuble, un homme qui meurt, sans vouloir le spoiler... Il voulait donner une impression de déliquescence, d'un monde qui tombe en ruine, avec cet homme aux cheveux gras et la respiration hachée. (...) J'ai repris dans Mad Men l'image d'un New York des années 70 qui se désagrège, où les services publics étaient alors terribles, la ville proche de la banqueroute", explique Matthew Weiner.

Référence suivante: la fraîcheur colorée de la comédie musicale de Jacques Demy, Les demoiselles de Rochefort. Dans l'extrait qu'il a choisit, on voit des jeunes hommes habillés en couleurs pastel chanter "Nous voyageons ici / ailleurs, dans la vie tout nous est facile". ''"Les hommes chantent et dansent autant que les femmes dans ce film, c'est sexy. Il a été influencé par West Side Story, mais il a un contrôle compte sur son univers. Ça semble familier mais c'est nouveau"'', détaille Matthew Weiner.
Son autre modèle, c'est Toute une vie de Claude Lelouch, dont l'anti-héros de son extrait évoque un peu Don Draper. Ce film se déroule sur une période de plus de 80 ans (de 1918 à l’an 2000), et raconte un coup de foudre entre Marthe Keller et un publicitaire (André Dussollier). Dans la séquence choisie par le showrunner, on voit sur scène un chanteur à succès (Gilbert Bécaud, qui joue son propre rôle), chanter "Si si si si la vie est belle...". En coulisses de son spectacle, il quitte une femme de façon peu amène. Dans la séquence suivante, on voit un homme échappé de prison rouler à toute vitesse en voiture: le réalisateur américain a été impressionné par le réalisme moderne de la scène (on a l'impression d'être dans la voiture !). Matthew Weiner s'est inspiré ici, pour Mad Men, de l'articulation entre les grands évènements historiques et le destin sentimental des personnages.
Il cite aussi un film en apparence plus léger, La notte de Antonioni. Là, "femmes et maîtresses dans la même salle, ce film illustre la décadence du mariage, comme dans Mad Men. Là, la difficulté était d'expliquer quand quelqu'un fait quelque chose de différent de la culture de l'époque. Don Drapper fait des films publicitaires, il doit être ouvert à de nouvelles idées", développe Matthew Weiner. Une manière d'expliquer en partie la vie personnelle sombre et parfois débridée de Don ? Ce film a directement inspiré un des épisodes de Mad Men (épisode 3 saison 3), "My Old Kentucky Home," dans lequel une énorme fête révèle l’échec du mariage Don/Betty.
Vient ensuite un classique de la comédie américaine, Les jeux de l'amour et de la guerre de Arthur Miller. "Le film se déroule durant la seconde guerre mondiale, il y a de superbes dialogues. Dans cette séquence, le personnage homme m'a inspiré Don Drapper: il plaisante, mais dit être un couard. Dans Mad Men, comme lui, Don a fui la guère du Vietnam et pris l'identité de quelqu'un d'autre".
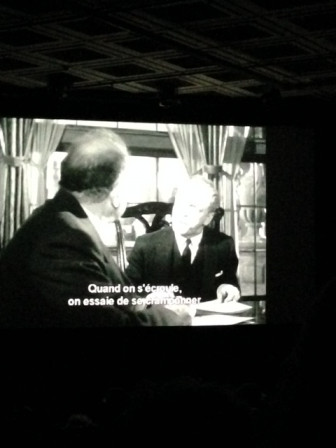
Autre référence pour lui, Patterns de Fielder Cook (1956). Dans la séquence qu'il a retenue, on voit une réunion d'un conseil d'administration dans un immeuble moderne à Manhattan, dans les années 60. Une vision peu amène du monde de travail, des premiers cadres sup' de l'époque, qui l'a sans doute inspiré pour les "pubards" de Mad Men. "On y voit une cruauté, comment quelqu'un se fait éjecter. J'étais malade à la maison quand je l'ai vu, ce film m'a terrifié : il n'y a pas pas de pistolets, mals le discours peut être une arme", commente le réalisateur. Ce qui est remarquable dans cette scène est que la tension naît de la succession rapide des prises de vues différentes, des contre-plongées, jusque la crise cardiaque en caméra subjective. De toute évidence, Patterns a influencé les séquences de Mad Men avec des réunions, qui traitent de pitchs, de finance, de rachats de sociétés et de faillites.
Matthew Weiner a aussi retenu ''Les bonnes femmes'' de Chabrol. "Je l'ai vu quand j'étais étudiant en cinéma, c'est un reflet de la classe moyenne de l'époque. On voit dans cette séquence des hommes qui violent une femme (interprétée par Bernadette Laffont), qui retourne travailler le lendemain, comme si de rien n'était. On voit le décalage entre les attentes romantiques de cette femme et la réalité cruelle".
Enfin vient le fabuleux Blue velvet de David Lynch. Matthew Weirner évoque l'ambiance électrique qu'il y avait dans la salle de cinéma lorsque Isabella Rossellini arrive nue face à Kyle MacLachlan et Laura Dern, sans que l’on comprenne réellement ce qu’il se passe à l’écran. Blue Velvet évoque pour Matthew Weiner la dureté du reaganisme des années 1980.


