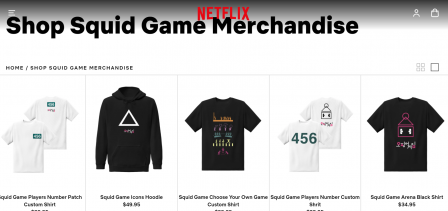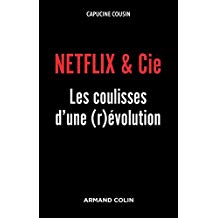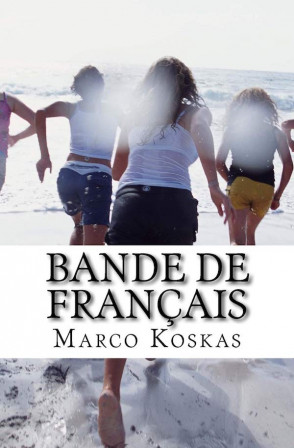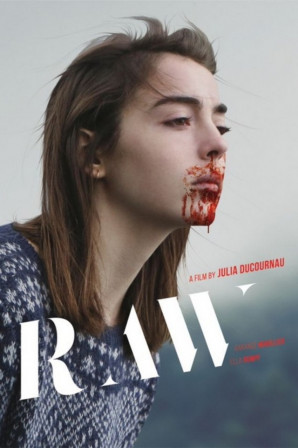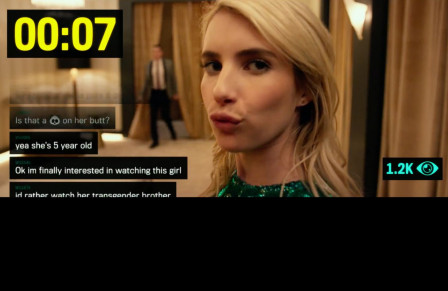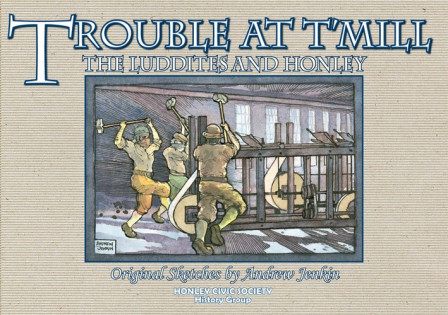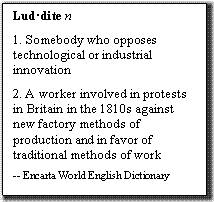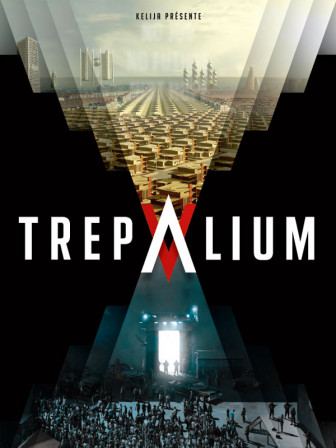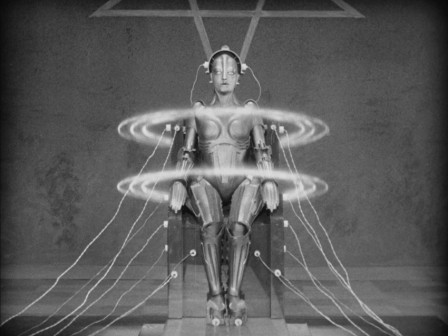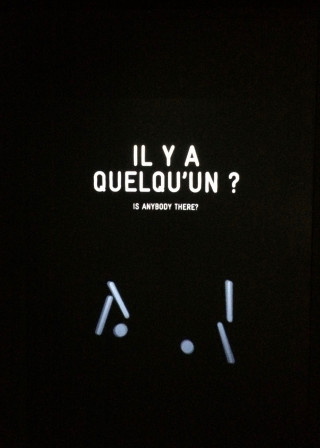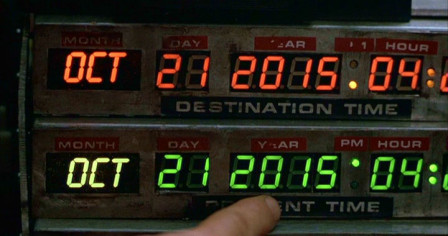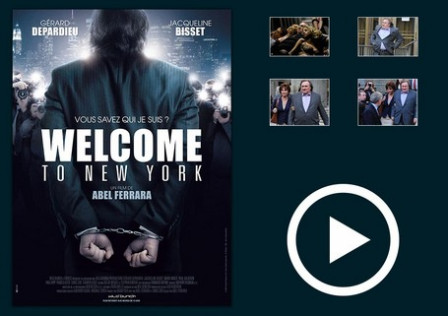Jill dans La trilogie Nikopol (Enki Bilal, ed. Les humanoïdes
associés)
2016, ça y est, nous y sommes... J'aurais pu, comme
beaucoup, tels Titiou Lecocq ou
Bigbrowser, écrire un bilan de l'année 2015. Une année particulière, dure
(j'avais l'impression de regarder le zapping annuel de Canal+ sous Xanax ces
derniers jours..), "poisseuse" me disait-on encore hier, où on a été secoués
par les attentats, où le vivre-ensemble de manière sereine est devenu
essentiel. Dans l'après-13 novembre, les questionnements (légitimes) se sont
multipliés. Pour ma part je me suis sentie sûre de ma chance, d'être toujours
là (en clair, en vie), à ma place, avec pour 2016 de nouveaux projets
professionnels bien kiffants (cela, vous en saurez plus ces prochains jours ;)
et personnels, plein d'envies, de nouvelles choses à accomplir. Alors je vis
sans doute plus dans le présent et l'avenir à préparer que le bilan du
passé...
Quoi qu'il en soit, j'en profite pour vous remercier pour cette nouvelle
année où vous avez continué à me lire, pour ce blog qui fêtera en février ses 9
ans (9 ans !) d'existence, et où vous avez été en moyenne 35 000 lecteurs par
mois à me lire ! Alors merci pour votre intérêt, vos réactions et votre
bienveillance. Et tous mes vœux de bonne année 2016, lectrices et lecteurs
chéris !
Pour bien attaquer 2016, outre le bilan de l'année 2015, j'ai envisagé le
traditionnel billet-marronnier sur les innovations et tendances tech les plus
attendues 2016 (donc comme vous pouvez l'imaginer, l'an I de la réalité
virtuelle, le nouveau chapitre des objets connectés, la multiplication des
écrans, l'après-4G, etc etc). Nooon pitié, m'a supplié un ami-lecteur hier. Ou
encore le 135ème billet sur Star Wars et la folie commerciale des
produits dérivés: sujet déjà traité à l'envi, dont par votre dévouée
dans cette enquête...
Finalement, en y réfléchissant, dans les événements de la culture
mainstream de 2015, un point commun positif s'est dégagé: enfin des
femmes fortes, des nouvelles super-héroïnes s'imposent comme personnages
principaux ! Je pense à deux films, deux des blockbusters les plus
attendus de 2015, Mad Max : Fury road (sorti en mai 2015), et
Star Wars : Le réveil de la Force (décembre 2015).
Deux wonder women dans deux blockbusters
Deux films qui ont plusieurs points communs : ils
s'inscrivent dans des sagas à gros budgets, avaient suscité une certaine
attente, pour l'un parce que c'était la première production par le géant Disney
(et non plus par le - soit-disant - petit poucet LucasFilms) ; pour
l'autre parce que ce quatrième opus était attendue depuis la sortie en 1985 de
Mad Max : Au-delà du dôme du tonnerre, avec plusieurs tentatives avortées
de George Miller. Tous deux sont des sagas-cultes de science-fiction,
inaugurées à l'aube des années 80 : le premier est une saga
intergalactique, dans le genre de space opera, le second une série de
courses-poursuites dans un monde post-apocalyptique, où les survivants tentent
d'organiser un monde nouveau.
Enfin et surtout, ces deux sagas ont longtemps été connotées plutôt
"masculines", en tous cas visant initialement un public plutôt masculin :
vous noterez que je prends beaucoup de pincettes ;) car à titre personnel, j'ai
beaucoup baigné dans la culture Star Wars (grâce à mon cher papa),
mais en sondant mes collègues et amies femmes, je me suis aperçue que cela
était loin d'être un film de chevet pour petites filles dans les années 80 ;)
Quant à Mad Max (que je connais beaucoup moins j'avoue), il montre une
dystopie, un univers sombre, assez violent, où l'on a beaucoup de scènes
d'action (comprenez de bastons, de courses-poursuites, d'explosions
spectaculaires).
Et donc, ça y est : reflet de l'époque, pour la première fois cette
année, Star Wars et Mad Max mettaient (enfin) en scène des vraies femmes
fortes, le pendant des super-héros. Des vraies badass girls,
"qui en ont". Un petit point vocabulaire s'impose quant à la définition de
Badass: le terme (appliqué initialement aux mecs) désignait initialement un
mauvais garçon dans l'argot US, avant de dériver de façon positive vers un dur
à cuire, qui a la classe, une sorte de héros en somme. Comme Clint Eastwood
dans Le bon, la brute et le truand : tout le monde s'interrompt,
même le pianiste, lorsqu'il pousse les portes battantes du bar, et commande son
double scotch. Il a ses dignes successeurs, comme Jules Winnfield dans Pulp
fiction.
Certes, on a vu quelques badass girls apparaître dans la culture mainstream
en sci-fi, telle Lara Croft, devenue l'icône de la franchise
de jeux vidéos Tomb Raider, Sarah
Connor dans Terminator 2: Le soulèvement des
machines, ou Trinity dans
Matrix (Et vous en trouverez sûrement
d'autres...).
Rey dans Star Wars : Le Réveil de la Force, "scavenger" habitée
par la Force

Star Wars : Le réveil de la Force, d'abord
(6,8 millions d'entrées en France à ce jour). Attention spoilers dans ce
paragrap.... Son personnage principal est une nouvelle-venue dans la saga,
Rey (jouée, comme souvent dans Star Wars, par une actrice méconnue, Daisy
Ridley, 23 ans), sans nom de famille connu : la jeune femme survit seule
sur la planète Jakku, une planète déserte rude, en revendant des pièces
détachées de machines et de robots ("scavenger" en VO, pilleuse d'épaves).
Comme naguère un certain Luke, elle s'accroche à l'espoir de retrouver sa
famille, Lorsqu'un robot droïde fugitif, le BB-8, l'appelle à l'aide, elle se
retrouve mêlée à un conflit d'envergure intergalactique, du côté des
Rebelles...
Ce qui est intéressant est qu'elle se revendique elle-même comme une
"no-one". Et pourtant, dès les premières séquences du film,
c'est une jeune femme émancipée et débrouillarde (en sommes très contemporaine)
qui se révèle : elle sait se battre seule pour éviter que l'on lui dérobe
le BB-8. Lorsque Finn veut lui porter secours, elle lui intime à plusieurs
reprises "Lâche-moi la main !". Elle sait démonter, réparer un robot
en un clin d’œil, ou décrire ses caractéristiques techniques de façon détaillée
(lorsqu’elle décrit le BB-8 à Kylo Ren). Loin de la robe virginale de princesse
Leia, elle est vêtue de manière minimaliste, de la même manière que Luke
Skywalker dans La guerre des étoiles (1977).
Elle sait piloter un vaisseau, dont le fameux Faucon
Millennium, de manière totalement instinctive ("Je ne sais pas où j'ai
appris à le piloter", avoue-t-elle à Finn). Surtout, elle possède la
Force, et apprend progressivement à la manier. Ce qui n'en fait pas (encore)
une Jedi puisqu'elle n'a pas suivi l'enseignement. On ne sais pas (encore) si
elle a des liens de parenté avec des Jedi, comme Luke Skywalker. Mais elle
apprend à la manier, et se situe dans le camp des Rebelles. Et surtout, elle
manie le sabre laser, enfin ! Dans toute la saga Star Wars, Rey est la
première femme (il a fallu attendre 2015 tout de même...) à recourir à la Force
pour se battre, et à manier le sabre. Face à des hommes.
C'est là la grande nouveauté, la grande émancipation, qui en fait la
première héroïne réelle de Star Wars. Lors de mon enquête pour
Stratégies, l'historien Thomas Snégaroff (auteur de l'excellent Je
suis ton père, ed. Naive) me disait à raison que "la princesse Leïa
était modelée par une vision assez conservatrice : elle a la Force mais ne
l'utilise pas, et se bat peu, à part pour utiliser parfois des fusils et
pistolets". D'ailleurs, dans ce dernier opus, on voit à plusieurs reprises
que Rey est en quelque sorte l'Elue, nouvelle dépositaire de la Force. Alors
que Leia en a hérité naturellement par son père, Dark Vador, mais ne l'utilise
pas.
Imperator Furiosa dans Mad Max : Fury Road

Imperator Furiosa dans le dernier opus de Mad Max, ensuite. Un des
autres blockbusters incontestables (2,3 millions d'entrées en France), et
mythiques de 2015. C'est Charlize Theron (40 ans), à l'image jusqu'alors plutôt
glamour, qui incarne ce personnage, crâne rasé et peinture de guerre noire sur
le front. A milles lieues de la jeune femme vêtue d'une robe lamé or dans les
pubs pour la parfum J'adore de Dior...
Dans un désert dévasté où survivent des humains, clans de cannibales, sectes
et gangs de motards, suite à une guerre nucléaire, l'"Imperator" Furiosa, c'est
donc la fidèle partisane de "Immortan Joe" (Hugh Keays-Byrne), un ancien
militaire devenu leader tyrannique. Elle le trahit et s'enfuit avec un bien
d'une importance capitale pour le chef de guerre: ses "épouses", un groupe de
jeunes femmes lui servant d'esclaves et de "pondeuses".
Au fil du film, on découvre une Furiosa qui a donc monté cette fuite, avec
une cause militante, assurer un autre avenir à ces jeunes femmes, et fuir
elle-même ce régime despotique pour un paradis rêvé, un territoire utopique où
elle est née. Preuve qu'elle a longuement préparé cette fuite, elle a même
conclu un accord pour pouvoir traverser un canyon contrôlé par un gang de
motards.

Cette femme munie d'un bras robotisé (son bras manquant est représenté sur
sa portière de camion), conduit et entretient son immense camion, doté d'un
antidémarrage qu'elle seule peut déverrouiller. Elle peut même le réparer en
s'agrippant en-dessous à son moteur, alors qu'il roule. Comme Rey, elle sourit
peu, sait se battre, manier les armes... Elle aussi est vêtue comme une
guerrière, avec un treillis kaki. A défaut d'une romance, une amitié
s'esquissera avec Max, qui la sauve en lui transfusant du sang. Dans cette
course-poursuite littéralement infernale, elle traversera une tempête, des
canyons, perdra un œil, et manquera de perdre la vie, avant de revenir
victorieuse la Citadelle avec sa prise - le cadavre de Immortan Joe - auquel
elle va succéder en toute probabilité. Une femme devenue personnage principal
d'un film de guerre, et s'apprête à prendre le pouvoir - la boucle est
bouclée...